Langues humaines, Parole divine
- Philosophe chrétienne

- 19 août 2021
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 sept. 2021
La Bible se présente elle-même comme Parole de Dieu. Cependant, elle a été écrite dans des langues humaines, par des humains, les textes ont été retouchés, sélectionnés, par des hommes. Comment concilier cette apparente contradiction entre Parole divine et langues humaines ?

Un nœud de problèmes :
Tout lecteur de la Bible se retrouve un jour face à ce problème provoqué par l'apparente contradiction entre l'affirmation que la Bible est la Parole divine, et la conscience qu'elle est écrite dans des langues humaines par des humains. Ce problème s'amplifie lorsqu'on étudie d'un peu plus près la formation des textes : leurs époques de rédaction, leurs auteurs, la sélection des textes, et les traductions. Je voudrais présenter 4 problèmes. Je développerai les 2 premiers, et je ferai sans doute d'autres articles pour les 2 suivants.
L'impossibilité pour le fini d'exprimer l'infini :
Premier problème, celui qui m'intéresse particulièrement dans cet article : les textes de la Bible se présentent comme étant la Parole de Dieu, nous expliquant qui est Dieu, son action dans ce monde, et ce qu'il attend de nous. Cependant, ils sont écrits dans des langues humaines. Affirmer que les textes expriment parfaitement et complètement qui est Dieu, serait ou rabaisser Dieu au rang des hommes, ou élever l'homme au rang de Dieu. D'un côté, Dieu est infini, illimité, éternel, tout puissant, omniscient. De l'autre, les langues humaines sont à l'image de leurs concepteurs : finies (#finitude), limitées, imparfaites, temporelles, quand bien même elles seraient d'une grande complexité, comme l'hébreu.
Que Dieu soit parvenu à incarner dans des mots humains, exprimant des idées humaines dans toutes leurs limites, la pensée parfaite, éternelle qu'il voulait nous transmettre, cela reste stupéfiant. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit là d'une prouesse, une sorte de miracle, d'intervention surnaturelle dans le naturel. En tentant de nous expliquer qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, dans notre langue, Dieu accepte forcément de se présenter de façon limitée : notre langue, nos mots, nos concepts, ne peuvent exprimer parfaitement qui il est, ce qu'il fait.
Je ne suis pas en train de dire que la Bible présente des erreurs sur Dieu. Elle dit la vérité, mais une vérité qui reste étroite, limitée. Oui, Dieu est bon, et nous nous faisons une idée de la bonté. Mais nous ne pouvons concevoir toute l'étendue, la profondeur, de cette bonté, tout simplement parce qu'elle est à l'image de Dieu : infinie, illimitée, parfaite, tandis que l'idée que recouvre le mot bonté pour nous est limitée. Cela nous appelle donc à de l'humilité : l'esprit humain ne peut embrasser le divin.
C'est une telle réflexion qui a mené le philosophe Descartes (#Descartes) à l'une de ses preuves de l'existence de Dieu : le fait même que nous puissions avoir en nous l'idée de perfection prouve que Dieu existe, car nous sommes trop limités et imparfaits pour avoir pu produire une telle idée.
L'exemple du premier mot de la Bible :
Donnons un exemple précis, et pour bien faire, prenons le premier mot de la Genèse : Bereshit. Ce mot hébreu donne son titre au premier livre de l'Ancien Testament : les Juifs l'appellent Bereshit. Il a été traduit en grec par : "Genesis", d'où Genèse en français. La traduction française de Bereshit, influencée par le grec, est : "Au commencement". Mais Bereshit ne signifie pas "commencement" tel qu'on l'entend en français. "Au commencement" évoque pour nous un commencement chronologique, le début du temps, le départ de la création, ce qui a existé en premier. D'où une lecture très chronologique de la suite du texte, par étapes successives et forcément chronométrées. Mais Bereshit recouvre plutôt l'idée d'origine.
La langue hébraïque a plusieurs mots pour dire "commencement". Elle aurait pu utiliser l'un d'entre eux, mais c'est Bereshit qui ouvre le livre divin. Ce mot ne se trouve nulle part ailleurs dans le texte de la Genèse. Unique, en quelque sorte. Ce qui rend sa compréhension et sa traduction difficiles, puisqu'on n'a pas d'équivalent sur lequel s'appuyer.
De plus, les lettres (consonnes) qui forment le mot Bereshit peuvent se combiner de 720 manières possibles, qui toutes ont un sens. Par exemple, 12 de ces combinaisons évoquent le Messie. Cela signifie que le mot Bereshit contient en puissance tous ces autres mots, les idées qu'ils recouvrent, les textes qui suivent. Être conscient de cela permet de faire preuve de plus d'humilité face aux traductions et aux interprétations des textes.
Inspiration divine :
Le deuxième problème est le suivant : les auteurs de la Bible affirment eux-mêmes que toute Ecriture est inspirée de Dieu (2 Timothée 3 : 16). Mais qu'est-ce à dire ? De quel genre d'inspiration parle-t-on ?
Il y a trois sortes de textes à distinguer : ceux dont les auteurs racontent une histoire, comme les Chroniques, Rois, ou les Evangiles ; ceux dont les auteurs affirment parler en étant inspirés par Dieu, comme les livres de la Loi mosaïque ou les Lettres du Nouveau Testament ; et enfin, ceux dont les auteurs affirment répéter les paroles que Dieu leur a dites, c'est-à-dire tous les livres des prophètes.
Quand il s'agit des livres prophétiques, on peut estimer qu'on parle d'une inspiration verbale, c'est-à-dire que Dieu a dicté chaque mot que les prophètes prononcent. Cela réduit un peu l'écart entre la Parole divine et la langue humaine, puisque Dieu a choisi lui-même les mots pour s'exprimer.
Mais quand il s'agit des autres textes ? Rois ou Chroniques, dont on sait que ces textes sont tirés d'archives royales, sont-ils issus d'une inspiration verbale ou contextuelle ? Dieu a-t-il dicté chaque mot à leurs auteurs, ou bien leur a-t-il inspiré le contexte général, à charge à eux de l'exprimer avec leurs propres mots ? On relève assez facilement, en effet, des différences de style dans la rédaction des divers livres. On repère facilement les changements d'auteurs, parfois au sein d'un même livre, à la façon qu'ils ont de rédiger leurs phrases. Si Dieu avait dicté chaque mot de toute la Bible, ne devrait-on pas retrouver une seule façon de s'exprimer ?
Ou encore, concernant la Genèse, dont la tradition affirme qu'elle a été écrite par Moïse : Dieu a-t-il inspiré Moïse verbalement, en lui dictant ce qu'il devait écrire concernant la création de l'univers, ou bien l'a-t-il inspiré par des songes, une vision, que Moïse a décrit avec ses propres mots ?
Je pose les questions, mais je n'ai pas la réponse. Quel est l'équilibre entre l'inspiration divine et l'empreinte propre des individus humains qui ont servi de récepteurs ? La question est posée, je doute qu'on puisse y apporter une réponse ferme et définitive. On peut par contre émettre des hypothèses.
Et les traductions ?
Troisième problème, déjà abordé dans le premier : celui de la traduction. Quand bien même on affirmerait que Dieu a dicté aux auteurs de la Bible chaque mot qu'ils ont écrits, ces mots sont hébreux et grecs, langues que peu d'entre nous sont capables de comprendre ! Nous avons donc besoin de traductions. Or, toute traduction est un travail humain, nécessairement imparfait, dans une langue imparfaite. Cela doit être pris en compte lorsqu'on lit la Bible en français, en anglais, etc. ; et quand on prétend fonder des interprétations doctrinales en s'appuyant sur des traductions, en prétendant que le texte "est clair", que "tel mot est employé". Je développe précisément ces questions de traductions dans cet article.
Et le choix des textes ?
Je pense développer ce dernier problème dans un article à part. La question de la sélection des textes qui forment la Bible pointe le problème des textes dits apocryphes. Les textes apocryphes sont des textes écrits par des Juifs (dans la période intertestamentaire) ou des Chrétiens (après le 1e siècle).
Concernant les textes écrits par les Juifs, on les divise en deux groupes : les textes deutérocanoniques, qui sont intégrés dans les Bibles catholiques mais rejetés par les Bibles protestantes (par exemple : Tobit, Judith, Maccabées...) ; et les textes apocryphes, souvent d'inspiration apocalyptiques (Apocalypse de Baruch, etc.).
Les textes écrits par les chrétiens sont qualifiés d'apocryphes, ce sont les écrits gnostiques par exemple, issus d'une secte du 2e siècle après Jésus-Christ, et jugés hérétiques.
Le canon biblique (c'est-à-dire les livres jugés d'inspiration divine, faisant autorité comme Parole divine) s'est formé petit à petit : d'abord celui de l'Ancien Testament, puis celui, plus rapidement, du Nouveau Testament. Plusieurs livres ont donc été rejetés du canon, mais - je l'ai dit - certains sont acceptés par les catholiques, d'autres sont unanimement rejetés. Quand on étudie l'histoire de cette sélection, on peut avoir l'impression d'un choix très humain, et se demander au nom de quels critères certains écrits sont acceptés, d'autres rejetés. On peut aussi considérer qu'il y a des critères très nets d'inspiration divine, qui ne laissent place à aucun doute. Développer tout ceci me mènerait trop loin, je m'arrête donc ici.
Si vous avez mené la lecture jusqu'ici, je vous en remercie ! Laissez-moi des commentaires sur ce qui vous a intéressé, posez vos questions, proposez des sujets ! C'est facile : il vous suffit de vous inscrire avec le bouton en haut à droite !

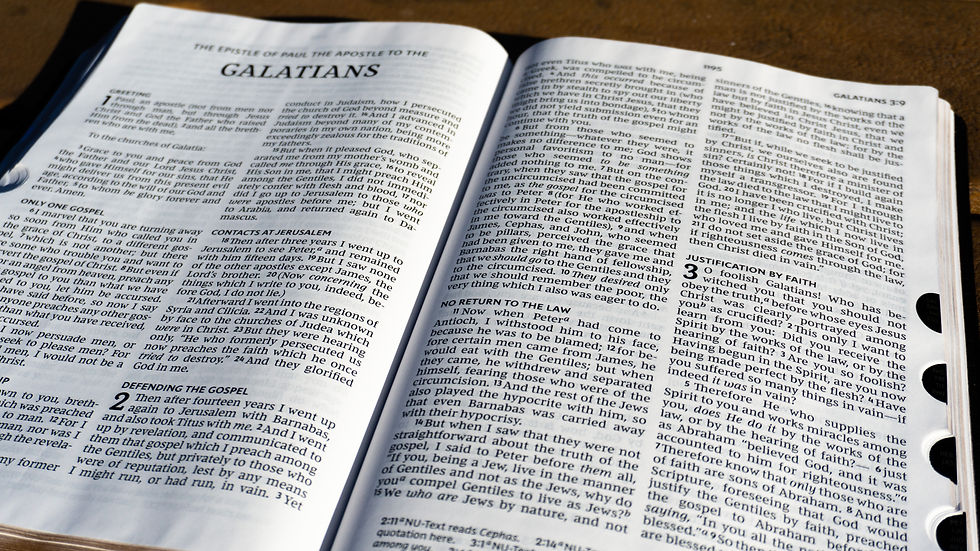

Commentaires